19 juillet 2011
2
19
/07
/juillet
/2011
14:51
 Harry, c'est fini... Voilà le rideau qui tombe sur une saga qui aura fasciné petits et grands pendant plus de 10 ans et qui continuera certainement à vivre par d'autres moyens. Difficile de conclure, tant de choses à dire, tant de choses à faire. Dès lors, la durée du film ne joue pas en sa faveur, 2h pour finir la quête des horcruxes, achever l'intrigue plus généralement, rendre son honneur à Rogue, donner une touche nostalgique à ce joyeux bazar... Enfin trop pour si peu de temps. L'enjeu était de bien finir une saga qui non sans défaut avait su se montrer irréprochable en tant que divertissement. Le problème est peut être là : boucler une saga qui tenait en son début de la magie rêveuse, par une fin obscurcie ( conformément aux romans ) va à l'encontre de cette volonté de rétrospective nostalgique presque obligatoire du fait que le film doit s'habiller comme une Conclusion d'ensemble; conclusion de l'intrigue mais de toute une aventure qui a dépassé son propre cadre depuis longtemps, et ce, avec une ampleur populaire extraordinaire. La saga Harry Potter est définitivement celle du mélange des entreprises, des styles, au point même de changer la nature même du matériau de base ( les premières adaptations ont beaucoup influencé J.K. Rowling; pas en elles mêmes mais dans l'impact qu'elles ont eu sur les fans ). Les coupures entre les films, les changements de réalisateur ont eu raison de la cohésion tout autant qu'ils ont apporté la richesse de la variété, un dernier opus ne saurait tout recoudre, raison comme une autre de la difficulté de l'entreprise d'hommage. Ainsi ce dernier volet est vacillant, tantôt convaincant, tantôt décevant, très hésitant sur l'ensemble puisqu'il veut tout contenter, on s'aperçoit ici que l'étirement de la saga l'a fortement délité. Touche à tout mais sur de rien Yates tente un final les yeux dans le rétro, en tablant sur les bases (on retrouve quelques personnages, quelques lieux bien connus non sans plaisir ) quitte à sacrifier l'intrigue, résumée à de rapides trouvailles. Même la bataille de Poudlard ne se vit pas, trop lointaine et donc moins viscérale, elle donne toutefois la part belle à quelques plans larges grandioses. Plus généralement le film manque d'emphase, on a jamais le sentiment de reconnaitre dans le film le passé glorieux d'une saga, encore moins d'assister à son dénouement. Tout comme la première partie le film est vidé du charme traditionnel des Harry Potter mais sans avoir cette fois la noirceur compensatrice qui constituait la qualité principale de son prédécesseur. En témoigne d'ailleurs les nombreuses morts déchirantes dans le livre, résumées ici à deux, trois plans sans réelle force d'évocation. De même que le combat Potter/Voldemort dont on attendait tous un duel acharné, un must du genre, et qui se révèle étrangement faible voire insipide. En revanche on peut être plus satisfait de la réhabilitation de Rogue via la Pensine qui, si elle aurait pu être encore meilleure, met en valeur une prestation bouleversante d'Alan Rickman qui encre son personnage comme le plus fascinant de la saga. Alors pour apprécier ce volet il faudra se satisfaire de ce que l'on a, principalement une belle démonstration visuelle, il faudra aussi accepter cet au revoir sans insistance, amère après la bataille, sympathique ensuite dans un épilogue moins ridicule finalement que celui du livre. Le film ne peut se targuer d'émouvoir, car à aucun moment l'émotion vient de ce que l'on voit, elle est simplement due au fait que l'on savait venir pour mettre un point final à cette aventure désormais inoubliable et qui aura façonné l'imaginaire collectif moderne, une réussite qui effacera les quelques défauts des adaptations cinématographiques elles aussi promises à une notoriété bien méritée.
Harry, c'est fini... Voilà le rideau qui tombe sur une saga qui aura fasciné petits et grands pendant plus de 10 ans et qui continuera certainement à vivre par d'autres moyens. Difficile de conclure, tant de choses à dire, tant de choses à faire. Dès lors, la durée du film ne joue pas en sa faveur, 2h pour finir la quête des horcruxes, achever l'intrigue plus généralement, rendre son honneur à Rogue, donner une touche nostalgique à ce joyeux bazar... Enfin trop pour si peu de temps. L'enjeu était de bien finir une saga qui non sans défaut avait su se montrer irréprochable en tant que divertissement. Le problème est peut être là : boucler une saga qui tenait en son début de la magie rêveuse, par une fin obscurcie ( conformément aux romans ) va à l'encontre de cette volonté de rétrospective nostalgique presque obligatoire du fait que le film doit s'habiller comme une Conclusion d'ensemble; conclusion de l'intrigue mais de toute une aventure qui a dépassé son propre cadre depuis longtemps, et ce, avec une ampleur populaire extraordinaire. La saga Harry Potter est définitivement celle du mélange des entreprises, des styles, au point même de changer la nature même du matériau de base ( les premières adaptations ont beaucoup influencé J.K. Rowling; pas en elles mêmes mais dans l'impact qu'elles ont eu sur les fans ). Les coupures entre les films, les changements de réalisateur ont eu raison de la cohésion tout autant qu'ils ont apporté la richesse de la variété, un dernier opus ne saurait tout recoudre, raison comme une autre de la difficulté de l'entreprise d'hommage. Ainsi ce dernier volet est vacillant, tantôt convaincant, tantôt décevant, très hésitant sur l'ensemble puisqu'il veut tout contenter, on s'aperçoit ici que l'étirement de la saga l'a fortement délité. Touche à tout mais sur de rien Yates tente un final les yeux dans le rétro, en tablant sur les bases (on retrouve quelques personnages, quelques lieux bien connus non sans plaisir ) quitte à sacrifier l'intrigue, résumée à de rapides trouvailles. Même la bataille de Poudlard ne se vit pas, trop lointaine et donc moins viscérale, elle donne toutefois la part belle à quelques plans larges grandioses. Plus généralement le film manque d'emphase, on a jamais le sentiment de reconnaitre dans le film le passé glorieux d'une saga, encore moins d'assister à son dénouement. Tout comme la première partie le film est vidé du charme traditionnel des Harry Potter mais sans avoir cette fois la noirceur compensatrice qui constituait la qualité principale de son prédécesseur. En témoigne d'ailleurs les nombreuses morts déchirantes dans le livre, résumées ici à deux, trois plans sans réelle force d'évocation. De même que le combat Potter/Voldemort dont on attendait tous un duel acharné, un must du genre, et qui se révèle étrangement faible voire insipide. En revanche on peut être plus satisfait de la réhabilitation de Rogue via la Pensine qui, si elle aurait pu être encore meilleure, met en valeur une prestation bouleversante d'Alan Rickman qui encre son personnage comme le plus fascinant de la saga. Alors pour apprécier ce volet il faudra se satisfaire de ce que l'on a, principalement une belle démonstration visuelle, il faudra aussi accepter cet au revoir sans insistance, amère après la bataille, sympathique ensuite dans un épilogue moins ridicule finalement que celui du livre. Le film ne peut se targuer d'émouvoir, car à aucun moment l'émotion vient de ce que l'on voit, elle est simplement due au fait que l'on savait venir pour mettre un point final à cette aventure désormais inoubliable et qui aura façonné l'imaginaire collectif moderne, une réussite qui effacera les quelques défauts des adaptations cinématographiques elles aussi promises à une notoriété bien méritée.
Voir aussi sur Lait caillé du Cinéma : Harry Potter 7.1

Published by BenLCDC
-
dans
Critique
7 juillet 2011
4
07
/07
/juillet
/2011
16:30
 Il fallait bien que ça arrive un jour, je savais au fond de moi que le niveau était tellement haut qu'un jour je trouverai un film coréen que je n'aimerai pas, c'est chose faite... Le problème est double, c'est que I saw the devil n'est pas juste dessous de ses prédécesseurs, il en aurait été excusé, mais c'est que tout simplement c'est un mauvais film ! L'histoire est simple, c'est celle d'une vengeance, c'est commun, tant pis beaucoup de film ont un pitch commun et sont très bons, ce n'est donc pas le véritable problème du film. Je préfère mettre les choses au clair d'entrée : je ne suis pas réticent à l'ultra-violence, ni à l'amoralité dans un film, le problème de ce film n'est pas qu'il soit complaisant ou encourage de quelques façons la violence - à y regarder de près on voit même que c'est l'inverse - mais c'est qu'il prétexte une réflexion noire sur les repésentations du mal au travers du concept de la vengeance sans jamais parvenir totalement à saisir la frénésie de la douleur, de l'Enfer qu'il borne à une simple imagerie gore. On pourra dire qu'il a préféré privilégier une incontrôlable fureur, une démesure qui ne devait en aucun cas être bridée, mais en fait cet engrenage malsain devient très vite banal, d'autant plus qu'étalé sur 2h20, il n'a même pas pour lui le dynamisme de son rythme. Du duel aux confins de l'horreur on ne tire qu'un débile glissement sémantique du titre du film ( plus encore avec le titre anglais ), au début interprété comme la rencontre avec le diable puis ouvert à d'autres possibilités : j'ai rencontré le diable qui était en moi etc. On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un film qui a pour seul but le déluge de sang, qu'il tente une réflexion sur le mal en parallèle, on voudrait apprécier le film, mais c'est tellement plat... On finit par saccommoder des scènes de boucherie, puisque livrées par pack de 15, elles n'ont plus d'autres effet que celui d'agacer et elles symbolisent par là tout un film qui ne parvient jamais à réaliser le crescendo horrifique qu'aurait du être le diabolique duel. On ne peut s'empêcher de repenser aux excellents The Chaser, ou encore Memories of murder évoqué directement dans une scène ( par un lieu ), cela renforce d'autant plus la frustration de voir un film qui n'a rien de semblable outre la nationalité avec ces deux pépites, un film qui sort à peine la tête de l'eau avec dix dernières minutes un peu meilleures. J'en attendais peut être trop, sans doute même, cependant le film fait tâche dans l'immense trésor du cinéma coréen qui avait donné l'habitude de film sans concession, certes, mais toujours sous couvert d'une intelligence et d'une mise en valeur purement cinématographique transcendant la matière de base qu'était le thriller. I saw the devil veut tout montrer, mais tout est caché, enseveli dans une marre de sang, et il ne ressort rien d'autre qu'un thriller faible qui trahit une à une ses promesses dont la première était de se délier de son genre pour mieux le faire briller, ou mieux, pour le retrancher dans les arcanes sataniques annoncées de façon propagandiste par le titre.
Il fallait bien que ça arrive un jour, je savais au fond de moi que le niveau était tellement haut qu'un jour je trouverai un film coréen que je n'aimerai pas, c'est chose faite... Le problème est double, c'est que I saw the devil n'est pas juste dessous de ses prédécesseurs, il en aurait été excusé, mais c'est que tout simplement c'est un mauvais film ! L'histoire est simple, c'est celle d'une vengeance, c'est commun, tant pis beaucoup de film ont un pitch commun et sont très bons, ce n'est donc pas le véritable problème du film. Je préfère mettre les choses au clair d'entrée : je ne suis pas réticent à l'ultra-violence, ni à l'amoralité dans un film, le problème de ce film n'est pas qu'il soit complaisant ou encourage de quelques façons la violence - à y regarder de près on voit même que c'est l'inverse - mais c'est qu'il prétexte une réflexion noire sur les repésentations du mal au travers du concept de la vengeance sans jamais parvenir totalement à saisir la frénésie de la douleur, de l'Enfer qu'il borne à une simple imagerie gore. On pourra dire qu'il a préféré privilégier une incontrôlable fureur, une démesure qui ne devait en aucun cas être bridée, mais en fait cet engrenage malsain devient très vite banal, d'autant plus qu'étalé sur 2h20, il n'a même pas pour lui le dynamisme de son rythme. Du duel aux confins de l'horreur on ne tire qu'un débile glissement sémantique du titre du film ( plus encore avec le titre anglais ), au début interprété comme la rencontre avec le diable puis ouvert à d'autres possibilités : j'ai rencontré le diable qui était en moi etc. On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un film qui a pour seul but le déluge de sang, qu'il tente une réflexion sur le mal en parallèle, on voudrait apprécier le film, mais c'est tellement plat... On finit par saccommoder des scènes de boucherie, puisque livrées par pack de 15, elles n'ont plus d'autres effet que celui d'agacer et elles symbolisent par là tout un film qui ne parvient jamais à réaliser le crescendo horrifique qu'aurait du être le diabolique duel. On ne peut s'empêcher de repenser aux excellents The Chaser, ou encore Memories of murder évoqué directement dans une scène ( par un lieu ), cela renforce d'autant plus la frustration de voir un film qui n'a rien de semblable outre la nationalité avec ces deux pépites, un film qui sort à peine la tête de l'eau avec dix dernières minutes un peu meilleures. J'en attendais peut être trop, sans doute même, cependant le film fait tâche dans l'immense trésor du cinéma coréen qui avait donné l'habitude de film sans concession, certes, mais toujours sous couvert d'une intelligence et d'une mise en valeur purement cinématographique transcendant la matière de base qu'était le thriller. I saw the devil veut tout montrer, mais tout est caché, enseveli dans une marre de sang, et il ne ressort rien d'autre qu'un thriller faible qui trahit une à une ses promesses dont la première était de se délier de son genre pour mieux le faire briller, ou mieux, pour le retrancher dans les arcanes sataniques annoncées de façon propagandiste par le titre.

Published by BenLCDC
-
dans
Critique
4 juillet 2011
1
04
/07
/juillet
/2011
12:11
 Balada triste est un film qui fait davantage dans la répulsion que dans la séduction, l'imagerie du cirque, et donc du clown, est telle que pourrait la décrire un enfant qui se réveille d'un cauchemar en sursaut. Poisseux, narquois, imprévisible le film est un immense piège qui travaille la résistance, bien sur en premier lieu et de façon métaphorique celle du passé douloureux de lEspagne, mais la résistance au sens général, celle des hommes face à la passion qui les embrase, à un désir irrépressible de réhabiliter une mémoire qui semble s'enfuir avec le temps. Emporté et sauvage, le film avance au gré des humeurs, des colères, des envies, il se laisse portée par sa propre fureur et se construit par poussée de fièvres interposées. Toutefois tout semble faire cohésion, se tenir dans une idée, qui bien que complètement marginale, ne souffre d'aucun écart, ou en fait s'édifie sur ses nombreux écarts et donc ne tombe jamais dans la banalité. Difficile à comprendre sans être plongé dans ce chaos sans nom. Peut être l'axe principal, celui par lequel on peut comprendre l'esprit du film, est celui de la monstruosité. Paradigme d'un film qui semble habité de toutes les folies, il montre qu'on peut tout à la fois lire l'évolution du personnage du clown triste comme une déchéance, ce qui semble logique, mais à y voir de plus clair, De la Iglesia ne ferme pas la porte à la lecture nietzschéenne du film, appelons ça comme ça, celle d'un assouvissement jusqu'au-boutiste de la passion où une décrépitude se transforme à un accomplissement titanesque d'une destinée acquise à coup de poignard. Balada triste a l'audace de délaisser son scénario plutôt simple aux instincts meurtrier de ses personnages, privilégier la démesure quitte à repousser, à choquer. Chacun se fera son avis, mais le film est pour moi une grande et belle surprise en 2011, un travail somptueux, inhumain ou trop humain (?), écorché, noir jusque dans son humour assassin où l'humour côtoie la mort. Une dualité symbolisée par le duel de clowns et qui finit par une scène à tomber par terre, juste un regard, comme dans un miroir brisé, monstrueux, dans tous les sens du terme.
Balada triste est un film qui fait davantage dans la répulsion que dans la séduction, l'imagerie du cirque, et donc du clown, est telle que pourrait la décrire un enfant qui se réveille d'un cauchemar en sursaut. Poisseux, narquois, imprévisible le film est un immense piège qui travaille la résistance, bien sur en premier lieu et de façon métaphorique celle du passé douloureux de lEspagne, mais la résistance au sens général, celle des hommes face à la passion qui les embrase, à un désir irrépressible de réhabiliter une mémoire qui semble s'enfuir avec le temps. Emporté et sauvage, le film avance au gré des humeurs, des colères, des envies, il se laisse portée par sa propre fureur et se construit par poussée de fièvres interposées. Toutefois tout semble faire cohésion, se tenir dans une idée, qui bien que complètement marginale, ne souffre d'aucun écart, ou en fait s'édifie sur ses nombreux écarts et donc ne tombe jamais dans la banalité. Difficile à comprendre sans être plongé dans ce chaos sans nom. Peut être l'axe principal, celui par lequel on peut comprendre l'esprit du film, est celui de la monstruosité. Paradigme d'un film qui semble habité de toutes les folies, il montre qu'on peut tout à la fois lire l'évolution du personnage du clown triste comme une déchéance, ce qui semble logique, mais à y voir de plus clair, De la Iglesia ne ferme pas la porte à la lecture nietzschéenne du film, appelons ça comme ça, celle d'un assouvissement jusqu'au-boutiste de la passion où une décrépitude se transforme à un accomplissement titanesque d'une destinée acquise à coup de poignard. Balada triste a l'audace de délaisser son scénario plutôt simple aux instincts meurtrier de ses personnages, privilégier la démesure quitte à repousser, à choquer. Chacun se fera son avis, mais le film est pour moi une grande et belle surprise en 2011, un travail somptueux, inhumain ou trop humain (?), écorché, noir jusque dans son humour assassin où l'humour côtoie la mort. Une dualité symbolisée par le duel de clowns et qui finit par une scène à tomber par terre, juste un regard, comme dans un miroir brisé, monstrueux, dans tous les sens du terme.

Published by BenLCDC
-
dans
Critique
21 juin 2011
2
21
/06
/juin
/2011
21:18
 Film à fleur de peau, romantique et réaliste, la confrontation d'un idéal et d'un impossible, celui perturbant et perturbé de l'amour. Est ce que l'amour existe ? N'est ce pas qu'une création dont on voit tous les jours les limites ? Blue Valentine s'attache à tout questionner, à tout entrevoir sans pour autant prétendre à quelconque redéfinition de la passion amoureuse. Le film est porté par le duo absolument fabuleux Ryan Gosling/Michelle Williams, deux acteurs qui ont insisté pour une mise en condition au préalable du tournage, et vu le rendu à l'écran on ne peut que les en remercier. Scénario également intéressant qui envisage par des allers et retours, de nouvelles approches, de nouvelles perspectives sans jamais chercher à cautionner ou accuser quoique ce soit mais plutôt avec l'intention d'encrer cette histoire dans une singularité édifiante qui met en déroute non pas l'individu mais la société dans laquelle il (sur)vit. Si le film est plaisant sur l'ensemble, il culmine dans sa facilité à transmettre une émotion ou même juste une pensée, Derek Cianfrance avec peu de moyen parvient à faire perdurer un climat chaotique sans jamais l'essouffler ou l'étouffer. Cette étonnante cohésion est sans doute possible grâce à la véracité du propos abordant avec passion et conviction les aléas du temps qui répondent à la nostalgie d'un passé heureux et la perspective d'un avenir plus radieux. Le film n'est pas une comédie romantique, bien trop grave pour l'être, il est baigné d'une tension sentimentale peu commune, surprenante qui joue sur un vacillement confondant d'ampleur tragique, sur le contraste entre un jeune couple plein de projets qui dérape vers une lutte entre deux amants qui ne se comprennent plus car ne se reconnaissent plus ( reconnaître l'autre, et finalement se reconnaître soit même ).
Film à fleur de peau, romantique et réaliste, la confrontation d'un idéal et d'un impossible, celui perturbant et perturbé de l'amour. Est ce que l'amour existe ? N'est ce pas qu'une création dont on voit tous les jours les limites ? Blue Valentine s'attache à tout questionner, à tout entrevoir sans pour autant prétendre à quelconque redéfinition de la passion amoureuse. Le film est porté par le duo absolument fabuleux Ryan Gosling/Michelle Williams, deux acteurs qui ont insisté pour une mise en condition au préalable du tournage, et vu le rendu à l'écran on ne peut que les en remercier. Scénario également intéressant qui envisage par des allers et retours, de nouvelles approches, de nouvelles perspectives sans jamais chercher à cautionner ou accuser quoique ce soit mais plutôt avec l'intention d'encrer cette histoire dans une singularité édifiante qui met en déroute non pas l'individu mais la société dans laquelle il (sur)vit. Si le film est plaisant sur l'ensemble, il culmine dans sa facilité à transmettre une émotion ou même juste une pensée, Derek Cianfrance avec peu de moyen parvient à faire perdurer un climat chaotique sans jamais l'essouffler ou l'étouffer. Cette étonnante cohésion est sans doute possible grâce à la véracité du propos abordant avec passion et conviction les aléas du temps qui répondent à la nostalgie d'un passé heureux et la perspective d'un avenir plus radieux. Le film n'est pas une comédie romantique, bien trop grave pour l'être, il est baigné d'une tension sentimentale peu commune, surprenante qui joue sur un vacillement confondant d'ampleur tragique, sur le contraste entre un jeune couple plein de projets qui dérape vers une lutte entre deux amants qui ne se comprennent plus car ne se reconnaissent plus ( reconnaître l'autre, et finalement se reconnaître soit même ).
Timide parfois mais sur l'ensemble puissamment dramatique, un éloge à la vie qui ne trompe pas sur le chemin de croix qu'elle peut devenir, mais un chemin de croix qui a ses moments éclairés, inspirés, et avec Blue Valentine on ne peut qu'être convaincu d'en vivre un beau, un vrai. Une surprise plus qu'agréable.
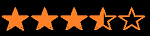
Published by BenLCDC
-
dans
Critique
12 juin 2011
7
12
/06
/juin
/2011
17:48

Critique rédigée dans le cadre du jeu-concours organisé par Price Minister : " Faites Votre Cinéma "
C'est souvent difficile d'écrire quelque chose sur un film qui laisse bouche bée, on a l'impression un peu comme Barton Fink dans le film, qu'il y a un monde de choses à dire, mais qu'on est pas capable de savoir lesquelles sont en adhésion avec nous même. Le quatrième film des frères Coen a cette étrange aptitude à être évidemment personnel mais tout à la fois s'ouvrir à chacun. Chacun peut y voir à peu près ce qu'il veut, en cela c'est
une uvre de cinéma dans ce qu'elle a de plus accompli mais en même
temps, Barton Fink est une évidente uvre absolue, qui confronte les
idées qu'il évoque à leur jusquau-boutisme, que ce soit une renaissance ou la fatalité de leurs appropriations.
Dès lors il s'agit de voir que Barton Fink se construit sur deux axes
associés dans la structure narrative et qui sont complémentaires dans la réflexion des Coen : le premier est celui de l'art, au sens parnassien, l'art qui n'a d'autre but que lui même ( l'esthétique ) et d'autre part l'histoire qui prend une dimension ici tout à fait originale car indissociable d'un contexte d'après guerre nourri de doutes, de troubles, d'espoirs et de déceptions. L'évolution de l'art, et finalement l'évolution de l'imaginaire collectif qui a subit les traumas de sa remise en question est une sorte de syndrome de réhabilitation qui tente de ressouder une identité autour d'idéaux communs. Or, et c'est le constat affligeant de Barton Fink, l'identité américaine n'a jamais existé autrement qu'en opposition à une autre, la vision rétrospective du film ( qui date 1991 ) englobe même de ce fait la construction d'une nouvelle identité par antagonisme vis à vis de celle proposé par le communisme. Le personnage de Barton Fink apparait comme cet américain moyen, qui part le travail a acquis une certaine notoriété, mais il est aussi et surtout la preuve que le système libéral ( triomphe de l'individualité ) est un leurre où l'individu est en fait soumis au passé d'un collectif national, qui bien que multifacette, est uni par ses hantises et ses espoirs. Barton Fink est une sorte de client parfait pour le maccarthysme grandissant, un homme auquel on jure qu'un mal est remplacé par un autre. C'est dans cette optique qu'on comprend mieux la place de l'art et de l'artiste dans le film. Reconstruire une identité c'est un travail de l'esprit, de l'imaginaire, la "feuille blanche" n'est pas autre chose que le symbole de cette immense tâche qui incombe à un individu finalement commun ( "the common man" ) auquel on demande de s'adapter ( son art et finalement lui même ) à un nouveau contexte, comme son pays doit s'adapter à l'ère nouvelle dont il se veut parrain mais dont il est aussi victime ( car dépassé par elle ) ! Pour l'écrivain l'adaptation est celle d'un univers de dramaturge, élégant bien que populaire, à un scénariste de série B aux ordres d'un producteur véreux et avide; pour les États Unis, c'est le passage d'un modèle de lutte pour le droit à un modèle de consommation outrance dans une optique de confrontation idéologique. l'interprétation de John Torturro est impressionnante en cela qu'elle cristallise autour d'un faciès et d'un comportement, une désorientation chronique propre à un siècle dextrêmes. C'est en fait la mutation système dans son ensemble qui est condamné, ses dérives voire ses déviances, son irrationalité qui le condamne à une âpre déchéance. L'alcoolisme d'une star hollywoodienne dans le film dont Barton Fink, fan de la première heure, ne peut se résoudre à voir succomber, participe à la transition du personnage central; et finalement son admiration transverse vers la femme de cet homme. il est intéressant de voir que le seul acte immoral de la part de Fink, l'adultère, se traduit par une sanction immédiate, celle de sa possible culpabilité et le remord qui l'accompagne.

Inséparable de son encrage historique, la force du film est tout de même d'arriver à le transcender, à faire de Barton Fink tout à la fois le symbole de ce changement radical de perception, et la figure symptomatique de la brutalité avec laquelle s'effectue le changement. Au final la place de l'histoire est engloutie par l'essentialisme du film et ne fait plus figure que de représentations mentales, bien plus que de caricatures modelées. Le style est à l'image de lhôtel, miteux, imprécis, vague, étrange, irréel. Un espace clôt qui semble entrouvrir à un univers de pensée, de conception. Pourtant Fink ne semble pas y trouver son inspiration, il lui faut le regard nouveau de son voisin de chambre Charlie, qui chaque jour lui fait part de nouvelle idée qui lui ont traversé l'esprit. C'est par leur rapport que le personnage de Fink évolue, il ne pouvait pas évoluer par lui même, tout comme l'art ne peut pas évoluer sans le monde qui l'entoure. La fin du film semble vouloir assombrir la lecture, mais finalement elle en est linsondable parachèvement. Lhôtel délabré prenant feu en même temps qu'on apprend la vérité sur un personnage central du film, apparait paradoxalement comme une résolution, un aboutissement mais également comme un nouveau drame, celui d'une tromperie que Fink n'a pu discerner dans l'étrange personnalité de Charlie. La mystique boîte ( qu'on retrouvera chez Fincher quatre ans plus tard ) est le symbole de toute cette interpénétration entre idée et accomplissement, c'est la clé du drame mais la clé de sa résolution, la réponse au meurtre et le nouveau questionnement quant à l'inspiration qu'il apporte à l'être irréprochable qu'est Barton Fink. Qu'il raconte la sordide histoire de ces personnages ou qu'il partage sa vision de l'art, le film assure toujours la prépondérance des sens sur le sens.

C'est quand on croit que tout d'un seul coup peut se coordonner pour faire sens, que nos sens nous piègent et délite le réel vers le rêve. La toute fin semble s'apparenter à la victoire de l'imaginaire sur la concrétisation, la victoire de la muse sur luvre qu'elle a inspirée, car tout ce qui est concret, tout ce à quoi on peut se rattacher n'est finalement comme l'environnement handicapant pour Barton Fink que l'image d'idéaux désacralisés par une réalité bien trop abrupte, corrompue par le triomphe de la matière sur l'esprit. Le génie du film est d'avoir su allier la réflexion à l'application, l'inspiration à la concrétisation dans un tout indissociable totalement désemparant de facilité et de richesse. D'autant plus renversant qu'il se permet d'expliquer une mécanique de l'esprit point par point, de servir d'exutoire à cette formulation de la pensée mais sans jamais la justifier. Il est l'antithèse de sa propre thèse, une question dont la réponse et la même question reformulée encore et encore. L'aboutissement dans le film étant l'accès ( réel, fantasmé ? ) à la muse tant vénérée, dont l'apparition est la preuve que plus qu'un moyen, celui de l'inspiration, chaque chose et avant tout une réalisation en tant que telle, dont la beauté doit se conquérir par l'esprit . Une sorte de disserte de surdoué qui ne se donnerait pas la peine d'apporter les preuves à la brillante démonstration qu'il accomplit, Barton Fink pourrait facilement être qualifier de film concept, d'essai, peut être qu'il faudrait aller chercher davantage à la page génie. Un chef duvre absolu.Se procurer le chef d'oeuvre
Published by BenLCDC
-
dans
Critique
11 juin 2011
6
11
/06
/juin
/2011
12:25
 Si on croit tout d'abord revenir aux bonnes vieilles heures du premier volet, avec l'enfance de Magneto dans le ghetto juif, le contre pied est lisible assez rapidement tant Matthew Vaughn cherche évidemment, dans le ton, dans l'image, dans l'idée, une rupture avec la saga. Plus intelligent, le film est aussi plus rigoureux dans son approche et nécessite donc une lecture d'autant plus alerte. En effet, X-Men se construit par lecture croisée entre philosophie de la différence et contexte historique. En s'imbriquant de façon spectaculairement fictive dans la guerre froide du début des années 1960, il trouve le paradigme du conflit idéologique, il en saisi la phase la plus critique. Le clou du film, et l'intérêt principal est d'être arriver à intégrer les mutants dans un contexte historique passé ( jusqu'alors on parlait d'un temps présent ) en ne se contentant pas bêtement d'exploiter le péril du monde. En effet, il y a une utilisation à la fois maligne mais intéressante des mutants comme enjeu peut être, toutefois pas dans la même logique que l'enjeu Tiers Monde, en troisième voie, mais plutôt comme acteur, nouveau sujet de débat et de combat, une sorte de nouveau bloc. Les liens des mutants avec un camp ou l'autre sont assez mal exploités en comparaison à l'évolution relationnelle des mutants entre eux, ceci dit l'idée générale d'intégrer une nouvelle "masse" est bien sentie puisqu'elle ramène les hommes à leur unité face au barbare, à l'inhumain, à l'inconnu. X-men retrouve le pessimisme de Watchmen, où l'homme ne peut s'unir que par le bas, que dans l'adversité, que face au monstre. La scène de la plage est ainsi le point culminant de ce film socio-politique, d'abord elle est la plus intense, la plus spectaculaire, mais elle est un condensé de tous ce que le film représente : le " bord du gouffre " de la Guerre Froide, que Vaughn propose ici de réécrire avec l'audace d'y intégrer la tant attendu séparation des mutants. Le duel Magneto/Charles Xavier se construit sur toute la durée du film, et concentre en lui tout le questionnement bien connu que propose traditionnellement X-men, celui du rapport aux hommes, entre les partisans de l'opposition jusqu'à l'éradication et ceux qui croient en la coexistence. Coexistence est ici un mot intéressant puisqu'il fut employé pour la première fois dans le but de qualifier le nouveau rapport entre les États Unis et L'URSS de Khrouchtchev qui après avoir dénoncé les crimes stalinien appelait à s'entendre avec le voisin. La crise des fusées à Cuba a donc un écho symbolique fort, celui de l'incapacité humaine à perdurer par la paix, l'échec de la coexistence pacifique. Le décryptage géo-politique tient tout à fait la route, bien que moins à l'aise pour en saisir l'essence comme l'a admirablement fait Watchmen, X-men s'en sert pour conter la genèse de mutants, leur premier rapport à la société, le premier rapport face à leur identité. La figure de Mystique est dans le film d'une importance prépondérante puisque l'évolution de sa perception, d'abord cristallise le problème mutant de l'acceptation physique de soi ( le cas du fauve est aussi intéressant ) et surtout la jeune femme participe à la divergence Magneto/Charles Xavier, point d'orgue et principal enjeu de ce film.
Si on croit tout d'abord revenir aux bonnes vieilles heures du premier volet, avec l'enfance de Magneto dans le ghetto juif, le contre pied est lisible assez rapidement tant Matthew Vaughn cherche évidemment, dans le ton, dans l'image, dans l'idée, une rupture avec la saga. Plus intelligent, le film est aussi plus rigoureux dans son approche et nécessite donc une lecture d'autant plus alerte. En effet, X-Men se construit par lecture croisée entre philosophie de la différence et contexte historique. En s'imbriquant de façon spectaculairement fictive dans la guerre froide du début des années 1960, il trouve le paradigme du conflit idéologique, il en saisi la phase la plus critique. Le clou du film, et l'intérêt principal est d'être arriver à intégrer les mutants dans un contexte historique passé ( jusqu'alors on parlait d'un temps présent ) en ne se contentant pas bêtement d'exploiter le péril du monde. En effet, il y a une utilisation à la fois maligne mais intéressante des mutants comme enjeu peut être, toutefois pas dans la même logique que l'enjeu Tiers Monde, en troisième voie, mais plutôt comme acteur, nouveau sujet de débat et de combat, une sorte de nouveau bloc. Les liens des mutants avec un camp ou l'autre sont assez mal exploités en comparaison à l'évolution relationnelle des mutants entre eux, ceci dit l'idée générale d'intégrer une nouvelle "masse" est bien sentie puisqu'elle ramène les hommes à leur unité face au barbare, à l'inhumain, à l'inconnu. X-men retrouve le pessimisme de Watchmen, où l'homme ne peut s'unir que par le bas, que dans l'adversité, que face au monstre. La scène de la plage est ainsi le point culminant de ce film socio-politique, d'abord elle est la plus intense, la plus spectaculaire, mais elle est un condensé de tous ce que le film représente : le " bord du gouffre " de la Guerre Froide, que Vaughn propose ici de réécrire avec l'audace d'y intégrer la tant attendu séparation des mutants. Le duel Magneto/Charles Xavier se construit sur toute la durée du film, et concentre en lui tout le questionnement bien connu que propose traditionnellement X-men, celui du rapport aux hommes, entre les partisans de l'opposition jusqu'à l'éradication et ceux qui croient en la coexistence. Coexistence est ici un mot intéressant puisqu'il fut employé pour la première fois dans le but de qualifier le nouveau rapport entre les États Unis et L'URSS de Khrouchtchev qui après avoir dénoncé les crimes stalinien appelait à s'entendre avec le voisin. La crise des fusées à Cuba a donc un écho symbolique fort, celui de l'incapacité humaine à perdurer par la paix, l'échec de la coexistence pacifique. Le décryptage géo-politique tient tout à fait la route, bien que moins à l'aise pour en saisir l'essence comme l'a admirablement fait Watchmen, X-men s'en sert pour conter la genèse de mutants, leur premier rapport à la société, le premier rapport face à leur identité. La figure de Mystique est dans le film d'une importance prépondérante puisque l'évolution de sa perception, d'abord cristallise le problème mutant de l'acceptation physique de soi ( le cas du fauve est aussi intéressant ) et surtout la jeune femme participe à la divergence Magneto/Charles Xavier, point d'orgue et principal enjeu de ce film.
Le film bénéficie donc de plusieurs grilles de lecture, un assez bon divertissement dont on peut regretter des affaiblissements dans le rythme et une propension à la dérision qui en permettant un certain recul sur la saga, l'apparition hilarante de Wolverine, enlève aussi au film un souffle tragique -hormis lépoustouflante scène de la plage- au profit d'un charme à l'ancienne, inopérant sur l'ensemble. Le privilège accordé au contexte, à l'intégration historique désarme la qualité intrinsèque du film, trop collé à son époque pour convaincre totalement. On aurait pu espérer que Vaughn parvienne à concilier son style décalé, juvénile avec un film de super héros plus rude, plus noir qui ne s'arrête pas à la vision adolescente d'un thème bien plus grave qu'il n'y parait. Sans lui reprocher de ne pas être le torturé Watchmen, on peut accuser l'évacuation de la noirceur du propos par une nonchalance bon-enfant qui faute d'ouvrir la voie à une interprétation plus détendue se trouve être gênante voire handicapante.
Published by BenLCDC
-
dans
Critique
10 juin 2011
5
10
/06
/juin
/2011
21:16

Après plusieurs éloges, toutes personnes confondues,
du professeur d'histoire consciencieux à l'adolescent moyen, du "
magistral " au " kiffant ", l'unanimité autour de ce film semblait
complètement inaltérable. Aussi, quelle était pas ma honte de ne pas
avoir vu ce film pour l'histoire, pour la mémoire, ce brulot contre la
haine, cet hymne à la vie. Et tu parles d'un cinéphile, le novice pour
qui Polanski, c'est le Ghost Writer... Néanmoins, un regard objectif sur
Le Pianiste est peut être aussi la "chance" de le percevoir d'une tout
autre manière.
Le film raconte l'histoire des juifs polonais
pendant la période nazie. Immersion dans une famille juive décimée par
la barbarie antisémite, on se retrouve très vite seul à seul avec l'un
d'entre eux, celui qui a survécu pour son aisance au piano et pour ses relations. Autant dire que le film propose de survivre avec Adrian
Brody, survivre à la bêtise, à l'ignorance, à la sauvagerie... Dommage
que le film fasse lui même preuve de certaines de ces caractéristiques.
Le sujet ne pouvant souffrir d'aucune critique de part sa nature de
film-mémoire, Polanski ne force pas quant à la tenue du film. Si la
reconstitution est entièrement satisfaisante, tout, ou presque, ce qui
est le fait de la réalisation est raté : un rythme atroce, un découpage
du temps à la hache qui étale un propos entrecoupé de manière tout à fait imbuvable ( alternance calme/tension, sauts dans le temps incohérents ). En voulant faire un travail propre, scolaire,
Polanski peu à peu se mutile, rend son film incapable de toucher, incapable
d'enseigner. Le rythme saccadé, le scénario additif, la sur-abondance de tout élément pouvant catégoriser le film comme modèle du genre ( horreur, larmes, faits historiques, dates...) enlèvent
sa puissance à l'image qui ici ne bénéficie même pas de l'excuse de la froideur, de l'abrupt car n'arrivant jamais à glacer son spectateur ou à l'accrocher... Le film travestie l'horreur en habitude, sa pratique du martelage rend tous les efforts de reconstitution vains. Seule la prestation d' Adrian
Bordy ressort de ce ramassis de formes convenues. Sa fragilité naturelle, son air innocent, parfois exploité de façon opportuniste par Polanski, font que le film rejette à travers lui cette cruauté, or elle ne ressort absolument que par lui, et son omniprésence finit par la vulgariser, la muer à cette incapacité générale à faire du cinéma vivant. On pense de suite à
l'autre film de ce genre, le très surestimé Le Vent se lève de l'ami
Loach, pour moi ces deux films se répondent parfaitement, une symétrie
de la pauvreté, qui ressemble à des films de commande, fait pour une
occasion et non par pure envie de cinéma. Plus le film avance plus on s'enfonce dans la niaiserie : le soldat allemand, le costume nazi... Et on touche le fond avec cette happy end ridicule, en totale contradiction avec le message du film. Comme Le Vent se lève, comme Amen, un film de plus sur
l'histoire et surtout sur la mémoire qui s'autoproclame comme référence avant d'être étonnamment adulé.
L'échec de Polanski réside dans son rendu atone, inodore, indolore, qui frise souvent l'agacement, et qui provoque même la colère, pas celle qui voudrait que son film est réussi à nous indigner, mais bien une colère contre une exploitation d'un académisme opportuniste, inadapté voire en contraste avec son thème, finissant même par nuire à un propos pourtant plus quhonorable. Pitoyable.
Published by BenLCDC
-
dans
Critique
18 mai 2011
3
18
/05
/mai
/2011
21:09
 Voilà bien un des films les plus attendus de l'année, pas pour moi, mitigé sur Malick en ayant vu du très bon ( La Ligne Rouge ) et de l'essoufflement ( Le Nouveau Monde ). J'allais juste voir un film et
je suis assez étonné de voir l'ampleur que prend le débat entre les
-non pas détracteurs, ce serait un euphémisme- défonceurs du dernier
Malick et les admirateurs qui se comptent sur les doigts d'un moufle. Je
pense que le fait que certains montrent autant de rejet, et d'autres
autant d'admiration pour le film fait état d'une sorte de mythification
du mec et de ses films, véhiculé par leur rareté, qui donne l'impression
dans les joutes critiques d'un débat plus idéologique que
cinématographique. Il y a bien matière à discuter du fond, Malick
exposant ici clairement sa chrétienté, or ce qui apparaît à raison comme
un film chrétien ne l'est pas plus que dans l'idée de confronter sans
cesse le mythe avec la réalité : illusions d'hommes et de femmes qui
guidés par des traditions, par une force transcendante ( la religion ),
se heurtent à l'incompréhension d'une vie qui leur est enlevé. C'est en
ce sens que je trouve qu'on est un peu dur avec Malick, sur le fait
qu'il ait fait ou pas un film théologique. Certes il y a de ça, mais
l'injustice de cette mort, ne remet elle pas en cause la bienveillance
d'un tout puissant ? Brad Pitt ne dit il pas qu' "il ne faut pas être
trop gentil" et parfois s'écarter des règles de vies du bon prêtre ?
Autant de choses qui rendent bancal le raisonnement à partir du seul
cadre religieux, trop restrictif pour une uvre si ambitieuse, si
étoffée, qui n'a de sens que dans l'expression d'une totalité parfois
contradictoire mais qui se construit sur ces différences, différences
qui vont parfois jusqu'à menacer la cohésion de l'ensemble, mais qui
participe aussi à sa perpétuation. Le
cas le plus probant est le rapport inter-générationnel ( parents/enfants
) ici mis au premier plan, vu comme la possible déchéance de l'humanité
alors même qu'il est le fondement de sa perpétuation. C'est
évoqué avec tant de maestria est de sensibilité qu'on ne prend pas
immédiatement la mesure de la perfection de toute la partie sur la
famille. Jamais un film n'avait saisi
avec autant de fulgurance les conflits intérieurs sous-jacents à
l'équilibre familial. Jamais la psychologie enfantine, avec ses
angoisses et son innocence, n'avait été portée à l'écran avec une telle
aisance.
Voilà bien un des films les plus attendus de l'année, pas pour moi, mitigé sur Malick en ayant vu du très bon ( La Ligne Rouge ) et de l'essoufflement ( Le Nouveau Monde ). J'allais juste voir un film et
je suis assez étonné de voir l'ampleur que prend le débat entre les
-non pas détracteurs, ce serait un euphémisme- défonceurs du dernier
Malick et les admirateurs qui se comptent sur les doigts d'un moufle. Je
pense que le fait que certains montrent autant de rejet, et d'autres
autant d'admiration pour le film fait état d'une sorte de mythification
du mec et de ses films, véhiculé par leur rareté, qui donne l'impression
dans les joutes critiques d'un débat plus idéologique que
cinématographique. Il y a bien matière à discuter du fond, Malick
exposant ici clairement sa chrétienté, or ce qui apparaît à raison comme
un film chrétien ne l'est pas plus que dans l'idée de confronter sans
cesse le mythe avec la réalité : illusions d'hommes et de femmes qui
guidés par des traditions, par une force transcendante ( la religion ),
se heurtent à l'incompréhension d'une vie qui leur est enlevé. C'est en
ce sens que je trouve qu'on est un peu dur avec Malick, sur le fait
qu'il ait fait ou pas un film théologique. Certes il y a de ça, mais
l'injustice de cette mort, ne remet elle pas en cause la bienveillance
d'un tout puissant ? Brad Pitt ne dit il pas qu' "il ne faut pas être
trop gentil" et parfois s'écarter des règles de vies du bon prêtre ?
Autant de choses qui rendent bancal le raisonnement à partir du seul
cadre religieux, trop restrictif pour une uvre si ambitieuse, si
étoffée, qui n'a de sens que dans l'expression d'une totalité parfois
contradictoire mais qui se construit sur ces différences, différences
qui vont parfois jusqu'à menacer la cohésion de l'ensemble, mais qui
participe aussi à sa perpétuation. Le
cas le plus probant est le rapport inter-générationnel ( parents/enfants
) ici mis au premier plan, vu comme la possible déchéance de l'humanité
alors même qu'il est le fondement de sa perpétuation. C'est
évoqué avec tant de maestria est de sensibilité qu'on ne prend pas
immédiatement la mesure de la perfection de toute la partie sur la
famille. Jamais un film n'avait saisi
avec autant de fulgurance les conflits intérieurs sous-jacents à
l'équilibre familial. Jamais la psychologie enfantine, avec ses
angoisses et son innocence, n'avait été portée à l'écran avec une telle
aisance.
Finalement Malick n'a pas voulu montrer autre chose que le fossé qui
sépare la conception nombriliste de l'homme avec une réalité
scientifique qui tend à relativiser, voire à ridiculiser cette
conception, à travers un nombre conséquents d'images évoquant la
puissance de la nature, l'immensité de l'univers. Cependant
il est vrai que leur compilation est parfois incohérente, additive et
la puissance de l'image n'est plus employée en tant que telle mais dans
une suite du type diaporama qui en altère l'essence magnifique.
C'est donc davantage un film sur le rapport de l'homme avec ce qu'il
entoure, et par quelles méthodes il identifie, il explique ce qui
l'entoure. Comment en est on arriver à exister ? Est on luvre finale,
darwiniste ou un élément quelconque de l'univers ? Du film il faut
arracher ces questions et en le prenant comme il vient, sans se braquer
sur la lecture religieuse de façon unilatérale, on s'aperçoit que le
film arrive à créer une sorte de tout, diversifié mais faisant bloc,
cohérent parce qu'il est soumis au même processus d'évolution. De cette
explication impossible de l'origine et de la finitude, Malick nous
propose sa voie, imparfaite car humaine. Si l'articulation de la
condition humaine avec la réalité
incompréhensible de l'univers au moyen du divin est contestable, elle
n'est ici pas imposée, mais simplement donnée comme un point de vue de
l'auteur qui de toute façon à d'autre argument à faire valoir : la voie
de la grâce... Ainsi il saisit l'essence des questionnements humains, des plus évidents aux plus complexes, ils ont tous pour objet de faire valoir une construction par la question et non dans la réponse.
Published by BenLCDC
-
dans
Critique
12 mai 2011
4
12
/05
/mai
/2011
16:18

Difficile d'aborder Essential Killing, un film qui se nourrit et établit son récit sur l'illisibilité, l'effacement des repères. Le problème est un peu le même que pour un film comme Dead man dans la manière d'appréhender le cinéma ( je sens déjà les pierres d'une future lapidation pour avoir dit ça ) où le réalisateur cherche à vider le film de références qu'elles quelles soient afin de servir une matière brute, bien que dans les deux films l'objectif ne soit pas le même : recherche de la pureté dans Dead man, exploration de l'inconnu dans Essential Killing. Mais à force d'épurer le film, de le vider (a priori) de sens, ne finit-il pas par n'avoir plus aucun intérêt ? Si l'idée est de faire parler les images, ne faut-il pas des images qui parlent ? Or le film n'arrive pas toujours à donner de l'ampleur à la photographie, ni de parvient à faire pâtir le spectateur des souffrances du personnage de Vincent Gallo. Le film est froid, inamical, primaire même, il ramène l'homme à sa condition sauvage, cest très clair avec les rencontres successives de Mohammed qui petit à petit se rapprochent d'une forme civilisée tel qu'on la conçoit aujourdhui ( jusqu'à la maison ), mais où à chaque fois il ne trouvera pas d'intérêt à rester. C'est que c'est un film sur l'errance ( sur la fuite ? ), même si elle prend parfois la forme d'une mission toutefois jamais si marquées qu'elles peuvent le paraître avec les échos à la religion musulmane pour mieux entrer dans la logique évoquée plus haut de la non-affiliation à quelques mouvements politiques, culturels, idéologiques que ce soit. Universel ou totalement inhumain, le film se murit après le visionnage, qui peut lui dérouter et décevoir, mais demande un effort d'ouverture assez conséquent qui peut paraître désagréable d'autant plus que la réalisation de Skolimowski n'aide pas vraiment à le faire avec un plaisir cinématographique certain, disons plutôt qu'on a à faire à une exploration difficile de l'existence et de la finitude.
Published by BenLCDC
-
dans
Critique
24 avril 2011
7
24
/04
/avril
/2011
19:15
 Dix ans après le mythique Scarface, Al Pacino retrouvait Brian De Palma dans L'Impasse. Impossible de ne pas noter la ressemblance entre les deux films, tant et si bien qu'on y est poussé par le fait que ce soit le même réalisateur, le même acteur principal. Mais au delà de ça, les éléments concordants sont nombreux, le parallélisme semble voulu ou du moins suggéré dans la structure globale. Il est intéressant dès lors de voir que, pourquoi pas, plus qu'un hommage anniversaire, Carlito's Way serait en fait une espèce de suite alternative à Scarface. Les deux personnages, immigrés hispanophones semblent comme liés l'un à l'autre ceci malgré leurs différences notables : le personnage plus mesuré de Carlito, face au pulsionnel Tony... Al Pacino a la maestria de tout à la fois incarner véritablement Tony Montana et Carlito Brigante avec la profondeur et la complexité propres à chacun mais en perpétuant une sorte d'osmose, une parenté évidente, ou même une unité, une fusion entre les deux personnages. En effet, sans aller chercher loin il n'est pas sot d'imaginer que Carlito Brigante serait un Tony Montana qui ayant connu un autre sort, celui de faire de la prison, se serait repenti sans nier ce qu'il est. Le personnage de Carlito Brigante ressemble à un Tony Montana éprouvé, plus réfléchi aussi qui voudrait mettre à dos son passé sans pour autant devenir un autre, mais faute de rattraper ses erreurs, ce sont ses erreurs qui le rattrapent. Cependant il est difficile de prêter à Tony M l'implacable sens de l'honneur de Carlito, et peu probable également que cinq années de prison tordent le caractère unique du gangster cubain. Autre limite à ce parallélisme, l'anachronisme des histoires, puisque Carlito serait un personnage dont la jeunesse serait postérieure à celle de Tony Montana ( déjà trafiquant de cocaïne, alors qu'on apprend que Carlito était le roi de l'héroïne ). Si on peut redoubler d'hypothèses quant aux volontés de De Palma en ce qui concerne l'éventuel lien entre les deux films, il est clair que l'objectif n'était pas de reprendre les détails de Scarface pour qu'ils s'emboitent à cette possible suite mais plutôt laisser planer un doute insondable et insolvable, afin de perpétuer par d'autres biais le mythe Tony Montana et de dresser de la sorte un pont invisible entre les deux uvres qui par delà leur singularité s'inscrivent toutes deux dans une étonnante cohérence d'esprit.
Dix ans après le mythique Scarface, Al Pacino retrouvait Brian De Palma dans L'Impasse. Impossible de ne pas noter la ressemblance entre les deux films, tant et si bien qu'on y est poussé par le fait que ce soit le même réalisateur, le même acteur principal. Mais au delà de ça, les éléments concordants sont nombreux, le parallélisme semble voulu ou du moins suggéré dans la structure globale. Il est intéressant dès lors de voir que, pourquoi pas, plus qu'un hommage anniversaire, Carlito's Way serait en fait une espèce de suite alternative à Scarface. Les deux personnages, immigrés hispanophones semblent comme liés l'un à l'autre ceci malgré leurs différences notables : le personnage plus mesuré de Carlito, face au pulsionnel Tony... Al Pacino a la maestria de tout à la fois incarner véritablement Tony Montana et Carlito Brigante avec la profondeur et la complexité propres à chacun mais en perpétuant une sorte d'osmose, une parenté évidente, ou même une unité, une fusion entre les deux personnages. En effet, sans aller chercher loin il n'est pas sot d'imaginer que Carlito Brigante serait un Tony Montana qui ayant connu un autre sort, celui de faire de la prison, se serait repenti sans nier ce qu'il est. Le personnage de Carlito Brigante ressemble à un Tony Montana éprouvé, plus réfléchi aussi qui voudrait mettre à dos son passé sans pour autant devenir un autre, mais faute de rattraper ses erreurs, ce sont ses erreurs qui le rattrapent. Cependant il est difficile de prêter à Tony M l'implacable sens de l'honneur de Carlito, et peu probable également que cinq années de prison tordent le caractère unique du gangster cubain. Autre limite à ce parallélisme, l'anachronisme des histoires, puisque Carlito serait un personnage dont la jeunesse serait postérieure à celle de Tony Montana ( déjà trafiquant de cocaïne, alors qu'on apprend que Carlito était le roi de l'héroïne ). Si on peut redoubler d'hypothèses quant aux volontés de De Palma en ce qui concerne l'éventuel lien entre les deux films, il est clair que l'objectif n'était pas de reprendre les détails de Scarface pour qu'ils s'emboitent à cette possible suite mais plutôt laisser planer un doute insondable et insolvable, afin de perpétuer par d'autres biais le mythe Tony Montana et de dresser de la sorte un pont invisible entre les deux uvres qui par delà leur singularité s'inscrivent toutes deux dans une étonnante cohérence d'esprit.
Moins spectaculaire, moins essentiel que Scarface, L'impasse fait pourtant bonne figure et exploite parfois de façon plus réfléchie et artistique des registres communs, on pense aux histoires d'amour des deux films qui se répondent l'une à l'autre avec plus de ferveur et d'émotion dans L'impasse ( voir la magnifique scène où Al Pacino, sous la pluie, admire sa belle danser ) et de façon plus physique et pragmatique dans Scarface, où la sublime Michelle Pfeiffer fait souvent figure de trophée pour ce Tony Montana définitivement plus amoral et opportuniste. L'Impasse n'égale donc pas son ainé, mais comment l'aurait-il pu ? D'un répondant spectaculaire, De Palma fait uvre originale, au sauvage et indomptable Scarface il préfère cette fois la voie réflexive et détachée d'une rédemption bouleversante. Immanquable.
Published by BenLCDC
 Harry, c'est fini... Voilà le rideau qui tombe sur une saga qui aura fasciné petits et grands pendant plus de 10 ans et qui continuera certainement à vivre par d'autres moyens. Difficile de conclure, tant de choses à dire, tant de choses à faire. Dès lors, la durée du film ne joue pas en sa faveur, 2h pour finir la quête des horcruxes, achever l'intrigue plus généralement, rendre son honneur à Rogue, donner une touche nostalgique à ce joyeux bazar... Enfin trop pour si peu de temps. L'enjeu était de bien finir une saga qui non sans défaut avait su se montrer irréprochable en tant que divertissement. Le problème est peut être là : boucler une saga qui tenait en son début de la magie rêveuse, par une fin obscurcie ( conformément aux romans ) va à l'encontre de cette volonté de rétrospective nostalgique presque obligatoire du fait que le film doit s'habiller comme une Conclusion d'ensemble; conclusion de l'intrigue mais de toute une aventure qui a dépassé son propre cadre depuis longtemps, et ce, avec une ampleur populaire extraordinaire. La saga Harry Potter est définitivement celle du mélange des entreprises, des styles, au point même de changer la nature même du matériau de base ( les premières adaptations ont beaucoup influencé J.K. Rowling; pas en elles mêmes mais dans l'impact qu'elles ont eu sur les fans ). Les coupures entre les films, les changements de réalisateur ont eu raison de la cohésion tout autant qu'ils ont apporté la richesse de la variété, un dernier opus ne saurait tout recoudre, raison comme une autre de la difficulté de l'entreprise d'hommage. Ainsi ce dernier volet est vacillant, tantôt convaincant, tantôt décevant, très hésitant sur l'ensemble puisqu'il veut tout contenter, on s'aperçoit ici que l'étirement de la saga l'a fortement délité. Touche à tout mais sur de rien Yates tente un final les yeux dans le rétro, en tablant sur les bases (on retrouve quelques personnages, quelques lieux bien connus non sans plaisir ) quitte à sacrifier l'intrigue, résumée à de rapides trouvailles. Même la bataille de Poudlard ne se vit pas, trop lointaine et donc moins viscérale, elle donne toutefois la part belle à quelques plans larges grandioses. Plus généralement le film manque d'emphase, on a jamais le sentiment de reconnaitre dans le film le passé glorieux d'une saga, encore moins d'assister à son dénouement. Tout comme la première partie le film est vidé du charme traditionnel des Harry Potter mais sans avoir cette fois la noirceur compensatrice qui constituait la qualité principale de son prédécesseur. En témoigne d'ailleurs les nombreuses morts déchirantes dans le livre, résumées ici à deux, trois plans sans réelle force d'évocation. De même que le combat Potter/Voldemort dont on attendait tous un duel acharné, un must du genre, et qui se révèle étrangement faible voire insipide. En revanche on peut être plus satisfait de la réhabilitation de Rogue via la Pensine qui, si elle aurait pu être encore meilleure, met en valeur une prestation bouleversante d'Alan Rickman qui encre son personnage comme le plus fascinant de la saga. Alors pour apprécier ce volet il faudra se satisfaire de ce que l'on a, principalement une belle démonstration visuelle, il faudra aussi accepter cet au revoir sans insistance, amère après la bataille, sympathique ensuite dans un épilogue moins ridicule finalement que celui du livre. Le film ne peut se targuer d'émouvoir, car à aucun moment l'émotion vient de ce que l'on voit, elle est simplement due au fait que l'on savait venir pour mettre un point final à cette aventure désormais inoubliable et qui aura façonné l'imaginaire collectif moderne, une réussite qui effacera les quelques défauts des adaptations cinématographiques elles aussi promises à une notoriété bien méritée.
Harry, c'est fini... Voilà le rideau qui tombe sur une saga qui aura fasciné petits et grands pendant plus de 10 ans et qui continuera certainement à vivre par d'autres moyens. Difficile de conclure, tant de choses à dire, tant de choses à faire. Dès lors, la durée du film ne joue pas en sa faveur, 2h pour finir la quête des horcruxes, achever l'intrigue plus généralement, rendre son honneur à Rogue, donner une touche nostalgique à ce joyeux bazar... Enfin trop pour si peu de temps. L'enjeu était de bien finir une saga qui non sans défaut avait su se montrer irréprochable en tant que divertissement. Le problème est peut être là : boucler une saga qui tenait en son début de la magie rêveuse, par une fin obscurcie ( conformément aux romans ) va à l'encontre de cette volonté de rétrospective nostalgique presque obligatoire du fait que le film doit s'habiller comme une Conclusion d'ensemble; conclusion de l'intrigue mais de toute une aventure qui a dépassé son propre cadre depuis longtemps, et ce, avec une ampleur populaire extraordinaire. La saga Harry Potter est définitivement celle du mélange des entreprises, des styles, au point même de changer la nature même du matériau de base ( les premières adaptations ont beaucoup influencé J.K. Rowling; pas en elles mêmes mais dans l'impact qu'elles ont eu sur les fans ). Les coupures entre les films, les changements de réalisateur ont eu raison de la cohésion tout autant qu'ils ont apporté la richesse de la variété, un dernier opus ne saurait tout recoudre, raison comme une autre de la difficulté de l'entreprise d'hommage. Ainsi ce dernier volet est vacillant, tantôt convaincant, tantôt décevant, très hésitant sur l'ensemble puisqu'il veut tout contenter, on s'aperçoit ici que l'étirement de la saga l'a fortement délité. Touche à tout mais sur de rien Yates tente un final les yeux dans le rétro, en tablant sur les bases (on retrouve quelques personnages, quelques lieux bien connus non sans plaisir ) quitte à sacrifier l'intrigue, résumée à de rapides trouvailles. Même la bataille de Poudlard ne se vit pas, trop lointaine et donc moins viscérale, elle donne toutefois la part belle à quelques plans larges grandioses. Plus généralement le film manque d'emphase, on a jamais le sentiment de reconnaitre dans le film le passé glorieux d'une saga, encore moins d'assister à son dénouement. Tout comme la première partie le film est vidé du charme traditionnel des Harry Potter mais sans avoir cette fois la noirceur compensatrice qui constituait la qualité principale de son prédécesseur. En témoigne d'ailleurs les nombreuses morts déchirantes dans le livre, résumées ici à deux, trois plans sans réelle force d'évocation. De même que le combat Potter/Voldemort dont on attendait tous un duel acharné, un must du genre, et qui se révèle étrangement faible voire insipide. En revanche on peut être plus satisfait de la réhabilitation de Rogue via la Pensine qui, si elle aurait pu être encore meilleure, met en valeur une prestation bouleversante d'Alan Rickman qui encre son personnage comme le plus fascinant de la saga. Alors pour apprécier ce volet il faudra se satisfaire de ce que l'on a, principalement une belle démonstration visuelle, il faudra aussi accepter cet au revoir sans insistance, amère après la bataille, sympathique ensuite dans un épilogue moins ridicule finalement que celui du livre. Le film ne peut se targuer d'émouvoir, car à aucun moment l'émotion vient de ce que l'on voit, elle est simplement due au fait que l'on savait venir pour mettre un point final à cette aventure désormais inoubliable et qui aura façonné l'imaginaire collectif moderne, une réussite qui effacera les quelques défauts des adaptations cinématographiques elles aussi promises à une notoriété bien méritée.![]()














